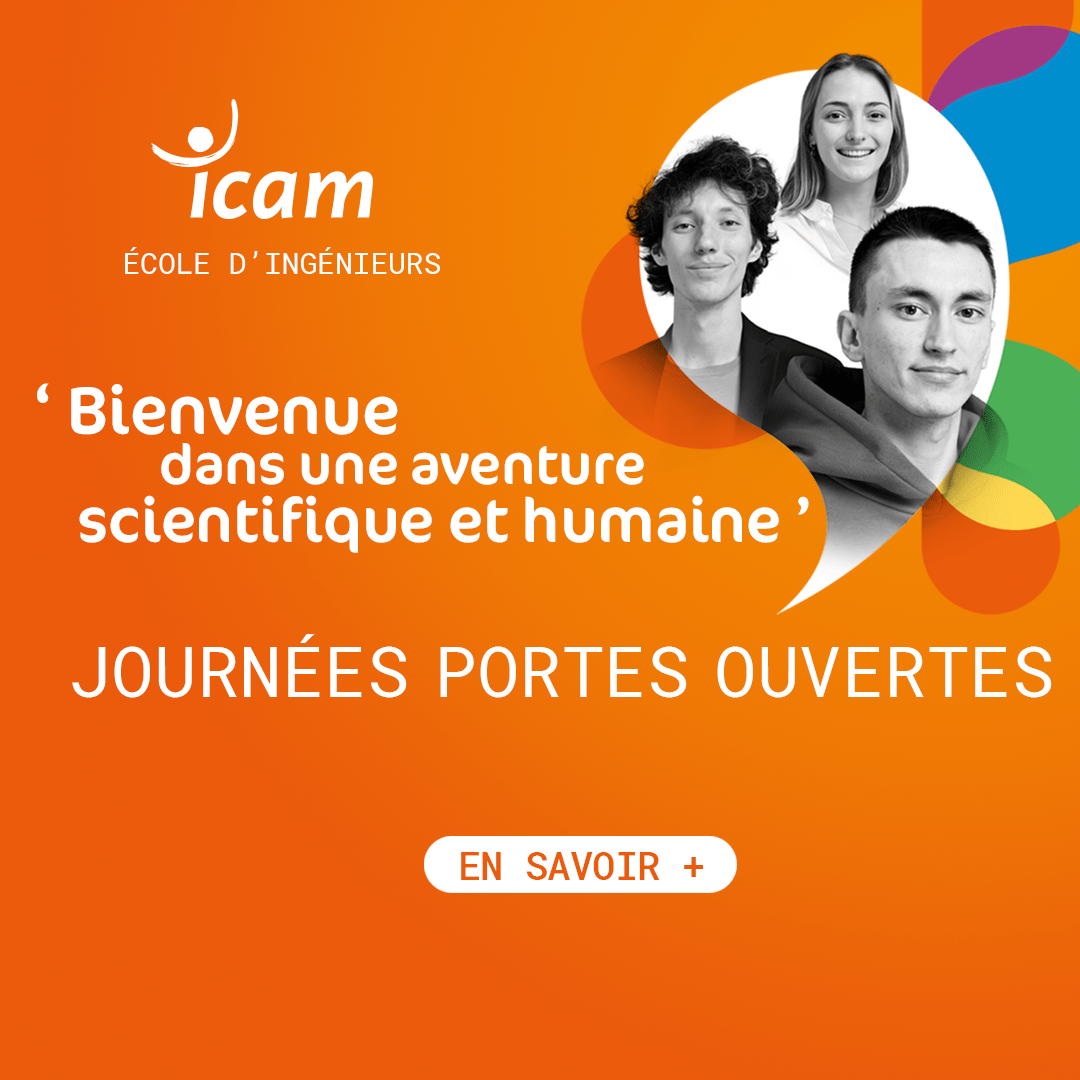Strasbourg-Europe
Thomas Schelcher est un étudiant en prépa internationale à l’Icam, site de Strasbourg-Europe. Passionné de musique et soutenu par l’école, il a construit un projet en tant que musicien de haut niveau ! Il nous en dit plus sur sa pratique musicale, son projet et son emploi du temps !
Thomas, un musicien à Strasbourg-Europe
Strasbourg-Europe
En juin 2023 se tenait la semaine de découverte des métiers à l’Icam, site de Strasbourg-Europe. Initiative de l’école, elle permet aux élèves de première année d’en apprendre plus sur les métiers du numérique, de l’entreprenariat ou encore de l’ingénierie !
Semaine de découverte des métiers à l’Icam, site de Strasbourg-Europe
Strasbourg-Europe
Un groupe d’élèves de l'Icam, site de Strasbourg Europe, s’est associé au Centre National d'Études Spatiales (CNES) et à l'association Planète Science pour réaliser le lancement d'une fusée expérimentale. Ce projet, nommé Stork 2.1, a commencé en septembre 2022 et implique sept étudiants passionnés par l'aéronautique et l'aérospatial.
Quand des étudiants de l’Icam lancent une fusée expérimentale